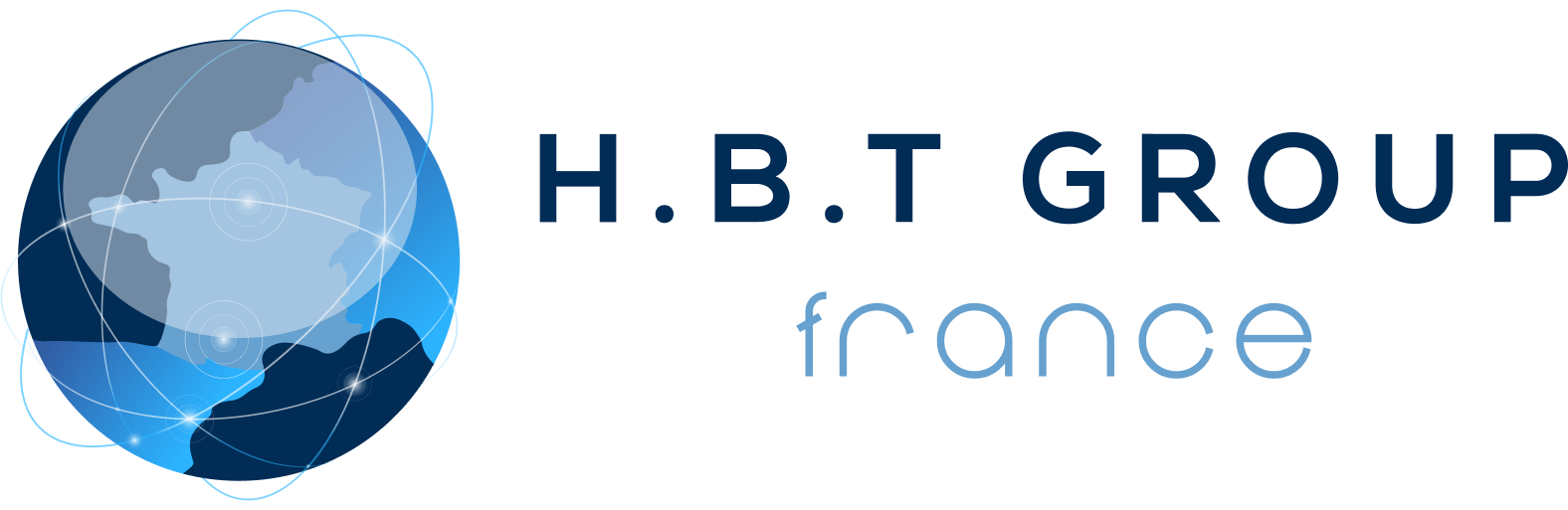Souvent discret, presque invisible pour le grand public, le transport sanitaire est pourtant l’un des piliers silencieux de notre système de santé. La France est d’ailleurs le seul pays au monde à garantir sa gratuité, intégralement financée par l’Assurance Maladie. Ce choix de société affirme un principe fort : permettre à chacun, où qu’il vive, d’accéder aux soins dans des conditions équitables.
Derrière ce service se cache une réalité financière importante : 6,8 milliards d’euros par an. C’est l’un des plus gros postes de dépenses de santé, juste après les salaires et les médicaments. Mais réduire le transport sanitaire à son coût serait passer à côté de l’essentiel. Il représente aussi de la sécurité, du confort et de la dignité pour les patients, ainsi qu’un soutien logistique crucial pour les hôpitaux et les soignants.
Des progrès réels, mais encore insuffisants
Depuis une dizaine d’années, des plateformes de régulation ont été mises en place dans certains établissements et groupements hospitaliers. Comparables dans leur logique aux grands acteurs privés de la mobilité, elles permettent de tracer chaque transport, d’optimiser les tournées et de mieux répartir les missions entre opérateurs. Les résultats sont probants : économies, transparence accrue et meilleure utilisation des ressources.
Pourtant, ces outils ne couvrent aujourd’hui que 10 à 15 % de la capacité nationale. La numérisation reste embryonnaire : peu d’établissements dématérialisent les prescriptions, l’usage des plateformes hospitalières reste marginal, et la traçabilité en temps réel est encore loin d’être généralisée. Malgré les succès locaux, le débat public continue de se focaliser sur le « coût excessif » du transport sanitaire, au point que l’exécutif envisage de transférer son financement directement aux hôpitaux, par ailleurs déjà fragilisés.
Vers une responsabilité partagée et une organisation plus efficace
Une autre voie existe : regrouper prescripteur et financeur en une seule entité, comme le permet déjà l’article 80 de la loi de 2017 via des forfaits transport. Ce modèle inciterait les établissements à optimiser non seulement les trajets eux-mêmes, mais aussi les moyens administratifs et logistiques associés. En intégrant la disponibilité des ressources de transport dans les plannings médicaux, on réduirait les retards et on favoriserait le recours au transport partagé, solution encouragée par l’Assurance Maladie.
La technologie ouvre également des perspectives ambitieuses. Interconnecter les plateformes actuelles, élargir leur périmètre au niveau régional ou national et bâtir un véritable service public numérique du transport sanitaire est désormais possible. Un tel dispositif, fondé sur le cloud et l’intelligence artificielle, centraliserait les demandes, validerait les prescriptions et attribuerait automatiquement chaque mission au transporteur le plus adapté. L’information circulerait en temps réel entre plateformes et transporteurs, permettant d’optimiser les flux physiques et d’exploiter pleinement les capacités de mutualisation.
Avec ce type d’outil, la croissance annuelle de l’activité (+6 à +8 % par an) pourrait être absorbée sans augmenter la flotte existante. À terme, la généralisation des plateformes et d’une interface nationale pilotée par la puissance publique pourrait générer une baisse des dépenses de 20 à 25 %, soit environ 1,5 milliard d’euros. Des expériences menées dans plusieurs hôpitaux en apportent déjà la preuve : grâce à la centralisation et au numérique, les véhicules passent de 40 % à plus de 60 % de temps utile, et le brancardage atteint jusqu’à 85 %.
Innover aussi dans l’organisation et la mobilité durable
Le transport sanitaire ne se limite pas à une fonction médicale : il est aussi un enjeu logistique et de transition écologique. Aujourd’hui, il repose encore largement sur une flotte routière composée d’ambulances et de véhicules sanitaires légers, dont l’impact environnemental est loin d’être neutre. Or, il est possible d’imaginer un modèle plus sobre et plus respectueux de l’environnement, sans sacrifier la qualité des soins.
De nouvelles approches émergent, notamment dans le champ de la mobilité durable. Le projet @Ecotrain, par exemple, vise à réhabiliter des lignes ferroviaires secondaires pour désenclaver des territoires isolés. Dans ce scénario, les trajets interurbains seraient effectués en train, puis relayés localement par des ambulances ou véhicules sanitaires légers. Ce type de solution permettrait d’ offrir une alternative à la fois écologique et économique, tout en apportant une réponse concrète aux besoins des patients vivant loin des centres hospitaliers.
D’autres solutions résident dans le regroupement des patients sur un même trajet, lorsque leur état le permet, optimisant ainsi les ressources sans compromettre la qualité du service.
Ainsi pensé, le transport sanitaire peut devenir un acteur clé de la mobilité durable. Il ne s’agit plus seulement d’assurer un service médical indispensable, mais aussi de contribuer à la transition écologique et à l’aménagement équilibré du territoire.
Lutter contre la fraude et renforcer la traçabilité
Un autre sujet sensible est celui de la fraude, dont le secteur est parfois accusé. Des contrôles existent déjà, mais il est possible d’aller plus loin. Un système national automatisé pourrait, par exemple, attribuer à chaque patient un nombre maximal de transports annuels adapté à son état de santé. Au-delà, un reste à charge progressif s’appliquerait. Les établissements recevraient des objectifs en cohérence avec leur activité, et les médecins libéraux seraient évalués selon la taille de leur patientèle. Des correctifs géographiques garantiraient l’équité, tandis que des mécanismes de bonus-malus inciteraient les transporteurs à adopter des pratiques vertueuses.
Enfin, il est urgent d’appliquer au transport de patients les standards logistiques déjà courants ailleurs : validation des commandes, prise en charge et fin de mission enregistrées par code ou géolocalisation, vérification de l’identité et de la destination. L’erreur de patient ou de lieu, loin d’être une légende, reste un risque réel. La Haute Autorité de Santé est particulièrement attentive à ces questions, car elles touchent directement à la qualité et à la sécurité du parcours de soins.
Un levier d’innovation pour tout le système de santé
Ces différentes pistes dessinent les contours d’un nouveau modèle où le transport sanitaire ne serait plus perçu comme une charge, mais comme un levier d’efficacité, d’innovation et d’équité. En combinant numérique, organisation et régulation intelligente, il pourrait devenir un outil puissant au service d’un système de santé plus juste, plus performant et toujours centré sur le patient.
Le transport sanitaire n’est pas un luxe : c’est un choix de civilisation. Il incarne une vision solidaire de la santé, accessible à tous, et respectueuse de chaque citoyen. La question est désormais claire : saurons-nous préserver et réinventer ce trésor national ?
Cet article a été rédigé en collaboration avec @Jean-Yves Gerbet, consultant et expert en logistique hospitalière & transports des patients. Engagé dans l’innovation et la prévention, il est membre du Comité d’Organisation de conférences scientifiques dédiées à la médecine préventive et à la longévité.


Hicham Temsamani
Hicham Temsamani est ingénieur biomédical avec une solide expérience internationale dans le secteur de la santé. Après un parcours au Centre National d’Études Spatiales (CNES), puis chez Panasonic, Cisco, Cardinal Health, AWS et Google Cloud, il fonde H.B.T Group France, son cabinet de conseil stratégique spécialisé dans la transformation numérique des organisations de santé. Engagé dans l’innovation et la prévention, il organise également des conférences scientifiques dédiées à la médecine préventive et à la longévité.